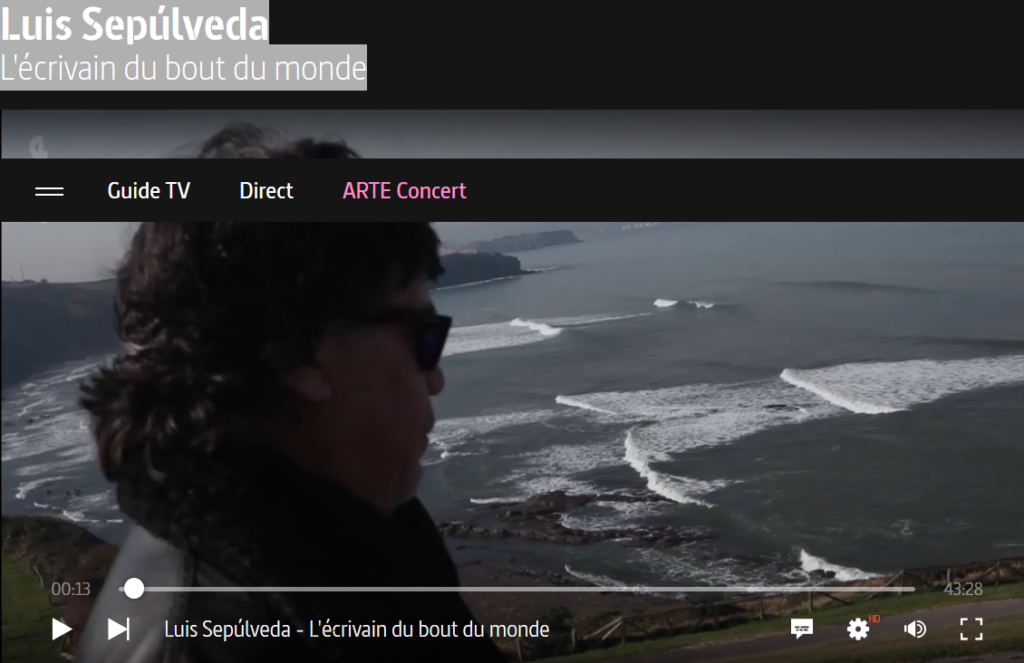« En parcourant le monde en long et en large, j’ai rencontré de magnifiques rêveurs, des hommes et des femmes qui croient avec détermination aux rêves.
« En parcourant le monde en long et en large, j’ai rencontré de magnifiques rêveurs, des hommes et des femmes qui croient avec détermination aux rêves.
Ils les tiennent, les cultivent, les multiplient. Moi aussi, avec humilité et à ma façon, j’ai fait la même chose. »
Luis Sepulveda
Le vieux ne lira plus des romans d’amour…

ll n’en écrira plus : Luis Sepulveda a rendu son dernier souffle ce 16 avril 2020, asphyxié par la dictature du COVID19 qui ne lui a laissé aucune chance en l’empêchant de respirer par lui-même. Et pourtant, il n’avait jamais manqué d’air, ce talentueux écrivain, né au Chili en en 1949, sang mêlé d’un exilé espagnol anarchiste, et d’une indienne Mapuche …
En 1973, il fait partie de la garde rapprochée de Salvador Allende : arrêté par les sbires de Pinochet, il est emprisonné, puis condamné à l’exil. Il n’est jamais revenu s’installer au Chili.
Il bourlingue comme journaliste à travers l’Amérique du Sud, s’intéressant aux peuples autochtones, prenant le pouls du monde, vivant même un temps auprès des indiens d’Amazonie.
Dans « Le neveu d’Amérique », il évoque l’accomplissement d’une promesse faite à son grand-père de retourner en Andalousie, dans le village d’où celui-ci, contraint à l’exil, était parti vers l’Amérique. Il se pose en Espagne, et décide d’y vivre.
Son premier roman résonne comme une fable écologiste : « Le vieux qui lisait des romans d’amour » lui apporte une renommée internationale, il est traduit en 35 langues.
En lutte auprès de Greenpeace de 1982 à 87, il n’aura de cesse de condamner ces bateaux usines qui massacrent les océans, le roman « Le monde du bout du monde » évoque cet engagement.
« La littérature raconte ce que l’histoire officielle dissimule. »
Luis Sepulveda
L’histoire du Chili est une toile de fond de ses polars politiques, « Un nom de torero », « L’ombre de ce que nous avons été », marquent la face noire de la dictature, toujours prégnante, le gouvernement actuel Chilien ayant pactisé avec des Pinochetistes, s’inspirant de leurs méthodes pour mater le soulèvement du peuple Chilien en cet automne 2019.
Violences policières en toute impunité, enlèvements, viols, atteintes innombrables aux Droits De L’Homme, résurgences d’un passé qui, de fait, ne l’est pas. Son dernier roman, publié en 2017, porte un titre prémonitoire :
« La fin de l’histoire. »
Françoise Briant Morizur , le 16 avril 2020.
Hommage à l’homme et à l’écrivain,

Chili, l’oasis asséchée

« C’était début octobre, quelques semaines à peine avant l’explosion sociale qui secoue le Chili dans toute la longueur de son étrange géographie. Une explosion qui, à la fin novembre, s’était traduite par plus de vingt morts, des centaines de mutilés, des milliers de blessés, un nombre indéterminé de détenus, des actes de torture, des agressions sexuelles et d’innombrables atrocités commises par la police et les forces armées. Juste avant ce basculement, le président chilien Sebastián Piñera s’était exprimé sur les convulsions qui balayaient le reste de la région. Il avait alors présenté le Chili comme une « oasis » de paix et de tranquillité au milieu de la tempête.
Ce n’était pas la présence d’une eau particulièrement douce, ni de palmiers au feuillage exubérant, qui caractérisait cette « oasis », mais les barrières apparemment infranchissables qui la ceinturaient. Les Chiliens se trouvaient du bon côté de cette clôture, forgée dans un alliage singulier : économie néolibérale, absence de droits civils et répression. Les trois métaux les plus vils.
Jusqu’à ce que la foule noircisse les rues chiliennes ces dernières semaines, les économistes et les dirigeants politiques qui s’accrochent au credo « moins d’État, plus de liberté d’entreprendre » comme à une bouée expliquaient qu’un miracle s’était produit au Chili. Presque par génération spontanée. De ce miracle, ils lisaient la preuve irréfutable dans les chiffres de la croissance et dans des statistiques économiques applaudies par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
Mais ce petit paradis austral n’existait pas pour l’ensemble de la population. Il ignorait tout de détails apparemment aussi subjectifs que le droit à un salaire juste, à des retraites décentes, à une éducation publique de qualité, à un système de santé digne de ce nom. Il ne s’intéressait guère au droit des citoyens à décider de leur sort, au lieu d’être relégués à la seule fonction de déglutir les chiffres macroéconomiques dont le pouvoir s’emploie à les gaver.
Le 11 septembre 1973, un coup d’État emportait la démocratie chilienne (1). Une dictature brutale s’installait à Santiago, où elle se maintiendrait pendant seize années. Non pour restaurer un ordre menacé, ou pour sauver la patrie de la menace communiste : le projet qui a motivé le coup d’État était de mettre en œuvre les préceptes des gourous du néolibéralisme, emmenés par Milton Friedman et l’école de Chicago. Il s’agissait d’instaurer un modèle économique d’un type nouveau, lequel engendrerait à son tour un nouveau type de société. Un monde contraint au silence, où la précarité serait la norme et l’absence de droits la règle. Un monde où les fusils se chargeraient d’assurer la paix sociale.
La dictature civico-militaire a atteint ses objectifs. Elle les a inscrits dans une Constitution dont le texte consacre le modèle économique instauré par la force et l’érige en définition du pays. Aucune autre nation latino-américaine ne s’est dotée d’une boussole aussi fidèlement alignée sur le bien-être d’une minorité, au mépris du reste de la population.
Avec le « retour de la démocratie », ou, pour mieux dire, la « transition chilienne vers la démocratie », à partir de 1990, les règles du jeu n’évoluent pas. La Constitution de la dictature est retouchée sans qu’on en modifie l’essentiel. Tous les gouvernements de centre gauche et de droite qui se succèdent s’emploient à maintenir le sacro-saint modèle économique, cependant que la précarité gangrène des pans de plus en plus vastes de la société.
Si, lors d’un repas, vous avez deux personnes et deux gâteaux, d’un point de vue statistique, la consommation est d’un gâteau par personne. Même si l’une des deux mange tout, sans rien laisser à l’autre. Voilà le tour de passe-passe qui permet au Chili de présenter son modèle comme une réussite : pas vraiment une dictature, pas vraiment une démocratie, il assure sa survie grâce à la répression et à la peur.
L’un des hommes les plus riches du monde, M. Julio Ponce Lerou, ancien gendre du dictateur Augusto Pinochet et héritier, par ordre du général, d’un empire économique bâti en dépouillant les Chiliens de ce qui leur appartenait, a versé d’immenses sommes d’argent à la majorité des sénateurs, des députés et des ministres afin qu’ils poursuivent servilement les privatisations. Lorsque la société l’a découvert, l’État a répondu en deux temps : il a suggéré que critiquer ces faits revenait à mettre fin au « miracle chilien » ; il a organisé la répression des manifestants.
Au Chili, l’eau appartient à une poignée de multinationales. Toute l’eau. Celle des rivières, des lacs, des glaciers. Lorsque des gens sont descendus dans la rue pour protester contre cette situation, l’État a engagé le seul dialogue qu’il tolère : celui qui répond aux revendications populaires par des coups de matraque.
Même chose lorsque la société s’est mobilisée pour défendre le patrimoine naturel menacé par les transnationales de la production d’électricité ; lorsque les lycéens ont exigé une éducation publique de qualité, libérée du monopole du marché ; ou lorsqu’une grande partie du pays a pris la défense du peuple mapuche, systématiquement opprimé. Chaque fois, l’État a eu la même réponse : réprimer et affirmer que les protestataires menaçaient le miracle économique chilien.
La paix de l’oasis chilienne n’a pas volé en éclats à cause d’une simple hausse du prix du ticket de métro à Santiago.
Elle a été rongée par les injustices commises au nom des statistiques macroéconomiques. Par l’insolence de ministres qui conseillent aux gens de se lever plus tôt pour économiser sur le coût des transports en commun (2) ; qui, face à la hausse du prix du pain, recommandent d’acheter des fleurs parce qu’elles, au moins, n’ont pas augmenté ; qui invitent à organiser des soirées bingo dans l’espoir de récolter des fonds pour réparer la toiture de ces écoles que la première ondée inonde.
La paix de l’oasis chilienne a volé en éclats parce qu’il n’y a rien de juste dans le fait de terminer ses études universitaires lesté d’un fardeau de dettes qu’il faudra quinze ou vingt ans pour rembourser.
La paix de l’oasis chilienne a volé en éclats parce que le système des retraites se trouve aux mains d’entreprises vampires, qui investissent les fonds qu’elles récoltent sur les marchés spéculatifs et font payer les pertes qu’elles enregistrent aux retraités, ces petites gens auxquels elles versent des pensions de misère, calculées sur la base d’une évaluation morbide du nombre d’années qu’il leur reste à vivre.
La paix de l’oasis chilienne a volé en éclats parce que, au moment de choisir la société qui gérera son compte de capitalisation pour la retraite, le travailleur, l’ouvrier, le petit patron doit avoir à l’esprit cette mise en garde des autorités : « La plus grande partie de ta retraite dépendra de l’intelligence dont tu auras fait preuve en plaçant ton épargne sur les marchés financiers. »
La paix de l’oasis chilienne a volé en éclats parce qu’une majorité de gens ont commencé à dire « non » à la précarité et se sont lancés à la reconquête des droits qu’ils avaient perdus.
Il n’existe pas de rébellion plus juste et plus démocratique que celle qui secoue le Chili.
Les manifestants exigent une nouvelle Constitution, qui représente l’ensemble de la nation, dans toute sa diversité.
Ils exigent qu’on revienne sur la privatisation de l’eau et de la mer.
Ils exigent le droit d’exister, et d’être considérés comme les sujets actifs du développement du pays.
Ils exigent d’être traités comme des citoyens, pas comme la portion congrue d’un modèle économique condamné à l’échec par son inhumanité.
Il n’existe pas de rébellion plus juste et plus démocratique que celle qui secoue le Chili.
Et il n’existe pas de répression, si dure et criminelle soit-elle, qui puisse entraver un peuple qui se lève. »
Luis Sepúlveda, écrivain chilien.
(1) NDLR. Lire « Il y a quarante ans, le coup d’État contre Salvador Allende », Le Monde diplomatique, septembre 2013.
(2) NDLR. Les tickets de métro coûtent moins cher en dehors des heures de pointe.
Luis Sepulveda – « Dernières nouvelles du Sud »
Le 7 avril 2012 , Luis Sepulveda passe à Mulhouse, à l’occasion de la parution de son nouveau livre « Dernières nouvelles du Sud », écrit avec la complicité de son ami photographe Daniel Mordzinski et publié aux éditions Métailié.
Un entretien vidéo de 7’20 » durant lequel il répond aux questions du blog littéraire « Passion Bouquins ».
« Le vieux qui lisait des romans d’amour »
14 mai 1992 : Olivier BARROT présente le roman de Luis SEPULVEDA traduit en français par François MASPERO. Mise en scène de personnages pittoresques en Equateur. Images d’archive INA
Luis Sepúlveda
L’écrivain du bout du monde
Avec ce portrait réalisé par Sylvie Deleule en 2011, ARTE rend hommage à Luis Sepúlveda dont la vie a basculé le 11 septembre 1973, comme celle de millions de Chiliens. Lui qui faisait partie de la garde rapprochée du Président Allende a participé à l’une des plus belles expériences de démocratie dans le monde. Écrivain et militant infatigable de toutes les causes, il rend hommage à ceux qui n’ont pu « continuer le combat ». Ce film est un plaidoyer pour ceux qui continuent inlassablement à résister.