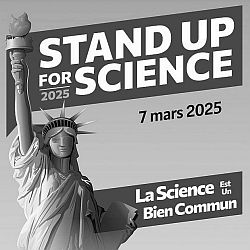 Les scientifiques contre-attaquent ! Vendredi 7 mars, une marche pour défendre la science était organisée à Washington et dans des dizaines de villes aux États-Unis, par le mouvement « Stand Up for Science ». Des scientifiques du monde entier ont rejoint le mouvement, notamment en France . Tour d’horizon des conséquences possibles à l’échelle de la planète des « purges exercées par Donald Trump et Elon Musk » …
Les scientifiques contre-attaquent ! Vendredi 7 mars, une marche pour défendre la science était organisée à Washington et dans des dizaines de villes aux États-Unis, par le mouvement « Stand Up for Science ». Des scientifiques du monde entier ont rejoint le mouvement, notamment en France . Tour d’horizon des conséquences possibles à l’échelle de la planète des « purges exercées par Donald Trump et Elon Musk » …  Un reportage vidéo de Radio-Canada ( 2’47 ») …
Un reportage vidéo de Radio-Canada ( 2’47 ») …
Un article paru dans The Conversation du 7 mars 2025 …

En écho au mouvement Stand Up for Science qui s’organise aux États-Unis pour défendre la liberté académique, un appel à la mobilisation a été lancé pour le vendredi 7 mars. Des conférences, des rassemblements et des marches sont organisées un peu partout en France, à l’initiative de scientifiques réunis derrière la bannière Stand Up for Science France. Engagé depuis ses débuts aux côtés de celles et ceux qui font avancer la recherche, « The Conversation » a demandé à Emmanuelle Perez-Tisserant, l’une des trois initiatrices du mouvement national, de nous expliquer pourquoi elle se mobilise.
« Ce 7 mars est un jour d’action en soutien à la liberté des personnes travaillant dans le domaine de la recherche aux États-Unis et dans le monde entier – 153 villes sont recensées sur le site standuforscience2025.org. La nouvelle administration états-unienne a frappé fort dès le 20 janvier, jour de la deuxième investiture de Donald Trump, en s’en prenant à ceux qu’elle perçoit comme des opposants, car leurs recherches vont à l’encontre de leur idéologie et de leurs intérêts financiers. Ce n’est pas complètement venu comme une surprise. Historienne des États-Unis, j’avais suivi les développements de la campagne et la trajectoire du parti républicain. J. D. Vance, l’actuel vice-président, avait proclamé que « le professeur [était] l’ennemi » en 2021.
Le réchauffement climatique, un « canular chinois »
Le premier mandat Trump avait laissé des traces et une première Marche pour les sciences s’est déroulée en avril 2017, à la suite de ses tentatives de faire taire les scientifiques travaillant sur le dérèglement climatique, de son allégation que le réchauffement climatique était un « canular chinois », de sa déformation grossière de l’histoire du pays ou encore de sa sortie des États-Unis des accords de Paris. Avec des collègues, nous avions relevé le défi d’organiser en France des manifestations de soutien, qui à l’échelle mondiale ont rassemblé environ 1 million de personnes.
Des purges dans des organismes de recherche et de régulation
Comme tous les autres domaines de l’action fédérale, les organismes de recherche et de régulation ont subi de plein fouet les attaques du DOGE, le département de l’efficacité gouvernementale d’Elon Musk, contre les emplois publics et leur supposé trop grand nombre, leur manque de performance et d’efficacité. Ces purges ont principalement touché les plus précaires, aux contrats les plus récents, dont la sécurité de l’emploi était moindre. Certains ont été licenciés pour manque de performance alors même que, quelques semaines auparavant, on les avait encouragés à candidater à une promotion.
D’autres services sont menacés, soit selon cette pure logique comptable, soit dans l’idée de remplacer les services publics par des services privés. Mais un certain nombre d’entre eux ne peuvent l’être sans détourner leur mission, car ils sont au service du public et leur but ne peut pas être de générer du profit financier : il en est ainsi des services de prévision météorologique, par exemple. Les attaques visent aussi les agences de régulation et de contrôle : de l’alimentation, des épidémies, qui protègent la population états-unienne. Là encore, comment penser que le pays s’en portera mieux ? Y compris d’un point de vue financier, la prévention étant moins coûteuse que le « damage control ».
Au-delà d’une idéologie anti-État, il faut comprendre d’autres logiques à l’œuvre dans ces mesures du gouvernement Trump. Il y a bien sûr les intérêts économiques liés à l’extractivisme fossile, dont les acteurs ont largement financé la campagne électorale côté républicain (comme ils ont financé les campagnes de mise en doute du réchauffement). Au lieu d’une « urgence climatique », le président a proclamé une « urgence énergétique », selon lui plus proche des besoins immédiats des Étatsuniens moyens.
Une tentative de casser le thermomètre
Dans le même temps, les mentions du réchauffement climatique ont disparu de la communication publique des agences fédérales et la responsable états-unienne d’un des groupes de travail du GIEC s’est vue interdire de se rendre aux réunions de finalisation du rapport tandis que son équipe était démantelée, lui ôtant de fait toute capacité à finir sa mission correctement. Les agences chargées de l’observation et de la surveillance des océans et de l’atmosphère, souvent appelée la NOAA, son acronyme anglais, ont aussi vu leurs rangs dépeuplés : une tentative de casser le thermomètre ? Pourtant ces organismes jouent un rôle précieux dans la vie de millions d’Étasuniens, et au-delà.
Trump et ses proches obéissent aussi à l’agenda conservateur, opposé aux politiques de diversité et vent debout contre le féminisme, le droit des femmes à disposer de leurs corps, les études de genre et l’application d’un programme de droits civiques pour les personnes LGBT et surtout trans. Cela s’est particulièrement vu dans la politique de réexamen des attributions de bourses fédérales à des projets scientifiques. Sont actuellement passés au crible tous les projets soupçonnés d’inclure une perspective dite DEI (diversité, équité, inclusion), ou encore correspondant aux mots clés aussi vagues que « femmes », pour ne citer qu’un exemple.
Le 5 mars, après examen, un certain nombre de bourses, attribuées par les « National Institutes of Health » (NIH) – qui avec ses 27 instituts et centres de recherche est le plus grand centre de recherche biomédicale dans le monde – à des projets déjà évalués et sélectionnés par des scientifiques, ont été annulées du fait de ces ordres venus du pouvoir exécutif après réexamen, car elles entraient dans les catégories visées par les ordres du président et des membres de sa majorité.
Par exemple, une étude de longue durée sur la santé des personnes LGBT+ qui incluait la population trans, particulièrement sous le feu des républicains.
Ou encore, le National Park Service (Service des parcs nationaux), l’agence fédérale qui gère les parcs et monuments nationaux et les lieux de mémoire, a ainsi supprimé un certain nombre de pages Internet, de documents ou de mentions d’activistes trans ou gay, comme c’est le cas pour le fameux bar qui a été un berceau des mobilisations gays, Stonewall (New York).
Attaque contre la liberté d’expression
La communication officielle comme les enseignements sont ainsi aussi touchés par cette censure alors que l’un des premiers ordres exécutifs de Trump se targuait de « restaurer la liberté d’expression », celle qui est fameusement sanctuarisée dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis.
Le 4 mars, sur son réseau social « Truth », le président a menacé de couper les financements fédéraux de toute université qui autoriserait la tenue de manifestations sur son campus, là encore, une infraction patente du principe de liberté d’expression. C’est notamment pour faire corps collectivement, et porter une voix menacée aux États-Unis, que sont organisées les manifestations Stand Up For Science, tandis qu’un certain nombre de nos collègues sont sidérés, tétanisés, effrayés de parler ou de s’exprimer lorsque leurs publications sur les réseaux ou leurs mails professionnels peuvent être scrutés, quand ils ne sont pas tout bonnement licenciés brutalement.
Abus de pouvoir
Ce qui est en train de se passer aux États-Unis relève d’abus de pouvoir, qui sont pour certains en train d’être attaqués en justice.
Le DOGE et Elon Musk, dont la création et la nomination n’ont pas été approuvées par le Congrès (et qui en profite en partie), sont en train de prendre des décisions budgétaires qui reviennent normalement à la branche législative. Or c’est une valeur fondamentale des États-Unis, depuis leur fondation, qui a été à la racine de leur indépendance : pas de taxation sans représentation ; les décisions budgétaires doivent être prises par les représentants élus par le peuple.
La recherche états-unienne au bord de l’effondrement
En attendant l’aboutissement de ces manœuvres judiciaires, et peut-être de la résistance des contre-pouvoirs et des citoyens que nous espérons constater aujourd’hui, aux dires de témoins, le système de la recherche états-unienne est au bord de l’effondrement, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le monde.
Cette situation et l’observation d’autres pays où des gouvernements similaires exercent, ou ont déjà exercé, nous incitent à la vigilance. Par exemple, en Argentine, le gouvernement Milei est en train de couper les financements publics de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales. Les chercheurs devraient, selon lui, trouver des financements privés : comment imaginer une recherche indépendante dans ces conditions ?
Il est clair que nous devons exprimer notre solidarité et la rendre concrète ; si nous ne parvenons pas à faire pression auprès des gouvernements pour rétablir la situation, il est essentiel de pouvoir offrir des formes d’asile à nos collègues états-uniens. La proposition de notre ministre de profiter des chaires juniors ou séniors ne saurait suffire et est difficile à accepter tant les postes, notamment les postes titulaires, sont rares en France, y compris pour nos brillants collègues en début de carrière, dans un contexte de coupes budgétaires tout à fait perceptible en France, et pas seulement aux États-Unis.
La situation en France
La situation n’est certes pas encore similaire en France, mais comment ne pas penser à une future arrivée au pouvoir de personnalités ayant ces mêmes idées, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons ? On le sait, on le constate, l’obscurantisme est un outil stratégique de l’extrême droite. Plus largement, au plus haut niveau de l’État, n’a-t-on pas relayé des accusations contre les mythes que seraient la « théorie du genre » et « l’islamo-gauchisme » ?
Est-ce que les scientifiques du climat, de la biodiversité, de la justice environnementale ne sont pas désespérés de ne pas être écoutés ou pris au sérieux dans leurs alertes ? Est-ce que les attaques contre l’Office français de la biodiversité (OFB) ne sont pas minimisées ? N’assiste-t-on pas à des reculs en matière de réglementation des pesticides alors même que l’on connaît leur nocivité ? Est-ce que les universités, parfois sous pression du pouvoir, ne pratiquent pas déjà des formes de censure, d’interventions policières et de restrictions de la liberté d’expression ?
Il est certain que ces enjeux sont complexes et qu’ils nous obligent à repenser complètement nos modèles, à revoir une bonne partie de l’organisation de la société, mais ne doivent-ils pas être réfléchis, discutés et débattus collectivement à partir de ce que nous savons et de ce qui est établi ? Il est impératif, par ailleurs, que ces débats tiennent compte des perspectives de sciences humaines et sociales, car les sciences sont profondément encapsulées dans nos sociétés, historiquement et géographiquement situées.
Comment collectivement mettre à l’abri ce qui doit nous être cher, dans lequel nous avons déjà collectivement investi, le fruit d’un long et précieux travail au service du public ? Constitutionnaliser les libertés académiques est-il possible et suffisant et sous quelle forme ? Rappeler que, selon la déclaration de 1948, le droit de jouir de – et de participer à – la recherche scientifique est un droit humain fondamental ?
L’enseignement et la recherche publics sont des biens communs, des richesses, qui peuvent bénéficier à toutes et à tous, qui doivent nécessairement s’inscrire dans le temps long et indépendamment des intérêts politiques et économiques, bien qu’en dialogue fécond avec la société. »
Les scientifiques debout contre l’obscurantisme, aux États-Unis comme en France
En réaction aux attaques de Donald Trump contre la science, des chercheurs du monde entier manifestent le 7 mars. Un mouvement d’ampleur pour bâtir une science loin des « régimes totalitaires ». Un article signé Vincent Lucchese dans Reporterre du 7 mars 2025 …

« Il y a eu un moment de sidération aux États-Unis, témoigne Olivier Berné, astrophysicien au CNRS et co-initiateur de la mobilisation Debout pour les sciences en France. Mes collègues là-bas n’osent plus s’exprimer, ils ont peur, ils ne s’attendaient pas à être attaqués à ce point-là. »
Nommer la menace totalitaire
Les multiples mobilisations prévues le 7 mars doivent permettre de dépasser ce marasme. « Des chercheurs s’organisent au niveau fédéral et à l’international, de manière spontanée et populaire. Ce mouvement est le premier et le seul grand mouvement de contestation aujourd’hui aux États-Unis », dit Olivier Berné.
Le premier objectif est de mettre des mots sur le basculement en cours. « Obscurantisme », « mise en application littérale et affolante de la dystopie orwellienne », « attaques d’une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale », disent les divers textes de collectifs de scientifiques.
« C’est du négationnisme scientifique d’extrême droite »
« On vit un moment illibéral, avec des méthodes faisant penser à des régimes totalitaires. Même si l’on n’a pas envie de sortir ce mot tout de suite, il faut attendre de voir la réaction des contre-pouvoirs, des États fédérés, de la justice, des mobilisations dans la rue », commente Emmanuelle Perez Tisserant, historienne spécialiste des États-Unis, également initiatrice de la mobilisation en France. Et d’ajouter : « Mais lorsque Trump menace de couper les financements aux universités qui autoriseraient des manifestations, cela fait clairement penser à de l’autoritarisme, voire du fascisme. »
Toutes les sciences ne sont pas logées à la même enseigne : les sciences sociales, les travaux sur les discriminations ou le genre notamment, et les sciences de l’environnement, climat et biodiversité en tête, sont les cibles privilégiées.
« Ils cherchent à museler ou supprimer les sciences les plus critiques : celles qui alertent sur les inégalités sociales ou l’urgence écologique, et montrent qu’un changement radical de société est nécessaire », dit Odin Marc, chercheur en sciences de la Terre au CNRS, membre de Scientifiques en rébellion et du collectif scientifique toulousain Atécopol, les deux organisations soutenant la mobilisation. Il l’affirme : « C’est du négationnisme scientifique d’extrême droite et une dynamique de criminalisation des lanceurs d’alerte, scientifiques et au-delà. »
L’Europe sur la même pente glissante
L’appel aux chercheurs et aux citoyens à descendre massivement dans la rue vise aussi à alerter sur l’ampleur des conséquences de ces attaques contre la recherche, et à leurs répercussions mondiales. Sur le climat, par exemple, les études et les données étasuniennes sont cruciales pour la recherche mondiale, via notamment les observations de la Nasa ou le travail de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Or, cette dernière vient d’être victime d’une vague de licenciements massifs, tandis que Katherine Calvin, scientifique en chef de la Nasa, a été interdite de participer à une réunion du Giec, dont elle est coprésidente d’un groupe de travail.

« Les données produites par les États-Unis sont étudiées dans le monde entier. Leur suppression ou restriction d’accès serait catastrophique. Cela montre notre très forte dépendance aux États-Unis et le besoin de repenser une forme d’autosuffisance dans la production des savoirs en Europe », dit Olivier Berné.
Ce qui suppose, a fortiori, que l’Europe ne suive pas le chemin des États-Unis. C’est l’autre signal d’alarme lancé par les chercheurs : « Ce qui se joue aujourd’hui aux États-Unis pourrait bien préfigurer ce qui nous attend si nous ne réagissons pas à temps », écrivent des scientifiques dans une tribune au Monde, qui appellent à rejoindre la mobilisation du 7 mars.
Les attaques frontales contre la science, et celles politiques et médiatiques, se multiplient aussi chez nous, en reprenant la rhétorique trumpiste : face à une crise, casser le thermomètre (ou les scientifiques) plutôt que de remettre en cause le modèle dominant. En France, sur l’écologie, le gouvernement comme l’extrême droite s’en sont pris brutalement ces derniers mois aux institutions scientifiques ou aux agences relayant les messages de la recherche.
Une mécanique délétère qui s’en prend à toute tentative de discours divergeant. « On le voit encore avec la décision de justice d’annulation du chantier de l’A69 [entre Toulouse et Castres]. Plusieurs journalistes ou élus s’en sont pris aux juges ou à la rapporteuse publique avec la même stratégie que Trump : décrédibiliser toute parole qui n’est pas la leur, quitte à inonder le débat de contre-vérités », souligne Odin Marc.
Bâtir une science ni fasciste ni capitaliste
La menace est aussi plus insidieuse. Elle passe par les politiques de destruction des moyens publics de la recherche depuis des décennies. « On sous-finance depuis vingt ans l’université. Des postes disparaissent chaque année au CNRS et il y a de moins en moins de financements par étudiant. Ce désengagement de l’État de la production de connaissances, c’est l’autre versant de cette pente glissante dans laquelle nous sommes engagés », prévient Olivier Berné.
Le collectif Scientifiques en rébellion dénonce également la multiplication des partenariats public-privé, les financements par projet au cas par cas, l’application d’une politique sélective « darwinienne » dans la recherche selon les performances des équipes, qui privilégie les gros projets et une science utilitariste, au service de l’industrie. En 2024, un rapport publié par un groupe de chercheurs alertait sur l’emprise croissante des intérêts privés sur la recherche publique en France. L’époque étant aux cures d’austérité drastiques, cette dynamique pourrait encore s’accélérer.
« Réclamer la liberté académique n’a pas de sens si on ne lui donne pas de budget. Sinon, la recherche est obligée de se lier à des intérêts privés. Il faut protéger la science du politique, en sécurisant son budget et en inventant des mécanismes pour qu’elle soit davantage en phase avec les besoins de la société », plaide Odin Marc.
Conventions citoyennes, forums citoyens et autres modalités d’interaction font partie des pistes avancées par Scientifiques en rébellion pour associer la société civile aux orientations de la recherche. « Protéger la science passe aussi pour nous par une critique de ses dérives actuelles. Il faut un vrai renouveau des relations entre science et société, pour que la production de connaissances soit vraiment au service de la démocratie et des nécessaires transitions écologique et sociétale », dit le chercheur.
Ce lien avec les citoyens est d’autant plus urgent à consolider face à la vague trumpiste. « Ce qui m’inquiète le plus, c’est qu’un certain nombre de nos concitoyens ne conçoivent pas les libertés académiques comme un bien à défendre, relève Emmanuelle Perez Tisserant. Un discours populiste qui gagne du terrain considère la recherche publique comme un repère de privilégiés. Il faut mieux défendre et formuler notre vision d’une science comme bien commun, comme savoir critique qui échappe à l’injonction de rentabilité économique. Sinon, ce sera toujours trop facile de couper les financements. »
+ Lire aussi : « Femme », « climat »… Trump interdit des mots dans les articles scientifiques
La recherche « dans un moment orwellien » aux Etats-Unis, regrettent plusieurs scientifiques français
Les scientifiques français Valérie Masson-Delmotte, Olivier Berné et Alain Fisher évoquent le contexte de la recherche américaine, dont les budgets sont en train d’être rabotés et les sujets de travail restreints drastiquement par l’administration Trump. A écouter dans le 7/10 de France Inter, cette vidéo de 24’40 » .
Aux États-Unis, les scientifiques manifestent contre une « censure sans précédent »
Budgets coupés, licenciements, censure… Des manifestations ont eu lieu dans une trentaine de villes des États-Unis, le 7 mars, pour s’opposer aux attaques de Donald Trump contre la science. Un article signé Edward Maille dans Reporterre du 7 mars 2025 …

Kaitlin Piper a obtenu le Graal l’été dernier. Une embauche comme enseignante en Santé publique à la prestigieuse université Emory à Atlanta, sans avoir idée des difficultés qui allaient toucher sa profession. Elle se retrouve désormais à brandir une pancarte « Arrêtez la guerre contre la science », aux côtés de centaines de personnes venues manifester à Atlanta.
Plus d’une trentaine de rassemblements similaires ont eu lieu vendredi 7 mars aux États-Unis, répondant à l’appel du mouvement Stand Up for Science (Debout pour la science). Les scientifiques ont souhaité faire entendre leur colère face au président Donald Trump.
Le nouveau gouvernement multiplie les coupes dans le budget et les licenciements dans l’administration, et les plus importantes agences scientifiques ne sont pas épargnées. Des données scientifiques ont été effacées de sites gouvernementaux. Et certains mots, tels que « climat », « genre » ou « équité », sont dorénavant à proscrire dans les rapports et publications, victimes de cette guerre contre le « wokisme » [1].
« Qu’on ne nous dise pas quels mots il faut employer », peste Kaitlin Piper, 31 ans. Elle a également fait une affiche, « Qu’Orwell redevienne une fiction », en référence au roman dystopique 1984 dans lequel « les scientifiques sont censurés ». « On dirait qu’on est en train de vivre dans ce livre, dit-elle. Cette censure contre les scientifiques aux États-Unis est sans précédent. »

Elle se réjouit tout de même, au milieu de la foule présente sur la pelouse devant le Capitole de Géorgie, de ne « pas être seule ». Des manifestations similaires avaient été organisées en 2017, quelques mois après la première arrivée de Donald Trump au pouvoir, révélant au monde sa théorie des « faits alternatifs ».
Bourses suspendues
Trois collègues, Jennifer Hurst-Kennedy, Diana Lancaster et Srebrenka Robic étaient déjà présentes il y a huit ans. Les biologistes à l’université Agnes Scott n’ont eu qu’à ressortir leurs pancartes. Elles évoquent les bourses suspendues pour des confrères, consœurs et étudiants s’ils faisaient référence au « D.E.I » (Diversité, équité et inclusion), devenu l’ennemi du gouvernement Trump.
« Des sites internet pour des bourses ont disparu », dit Srebrenka Robic, 49 ans. « L’ensemble de l’enseignement supérieur va être touché, ajoute Jennifer Hurst-Kennedy, 43 ans. Les bourses payent nos salaires. » Diana Lancaster, 41 ans, s’alarme : « Il ne s’agit pas d’attendre seulement quatre ans, la perte de ces formations aura des conséquences pour les prochaines générations. »

Des scientifiques prennent la parole devant la foule, avec des pauses musicales animées par un groupe de rock — doté d’un guitariste vêtu d’une blouse blanche. « La science est politique », affirme l’une des oratrices. Dans la foule, Tara Wyman, 63 ans, écoute tout en gardant un œil sur ses élèves. La professeure de physique-chimie accompagne une douzaine de lycéens. « La science ne devrait pas être politique », regrette-t-elle. C’est effrayant de voir ces agences être réduites au silence. »
« Il va falloir des années pour réparer tous les dégâts »
Une de ses élèves, 14 ans, tient une pancarte avec de la fumée grise qui s’infiltre dans des poumons. « La science est importante pour moi », explique celle qui a une maladie auto-immune. « Je suis souvent malade. Sans les vaccins, je le serais encore plus et j’aurais du mal à rester vivante », plaisante d’un rire doux-amer celle qui aurait dû passer son vendredi après-midi en cours d’espagnol.

Peu avant la manifestation, Frank Bove, 73 ans, distribuait des tracts. L’épidémiologiste environnemental a travaillé pour des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) — la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique. Désormais à la retraite, il est en « colère ». « Ils licencient les gens sans avoir un plan, des personnes qui viennent de démarrer leur carrière, celles qui étaient censées me remplacer. Ils sont en train de couper dans l’avenir de l’agence », dit-il. Sous couvert d’anonymat, une employée des CDC redoute les conséquences pour l’avenir : « Même si le gouvernement arrêtait maintenant, il va falloir des années pour réparer tous les dégâts provoqués. »

Une réponse sur “Les scientifiques debout contre l’obscurantisme …”
Les commentaires sont fermés.