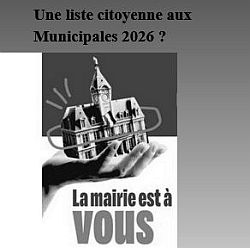 Du 21 au 24 août 2025, Poitiers accueillait les 7èmes « Rencontres nationales des listes citoyennes et participatives ». Des hommes et des femmes sont venus de nombreuses villes françaises pour se former et échanger sur une forme de démocratie plus directe en vue des prochaines municipales. En 2020, 384 listes citoyennes s’étaient présentées en France, combien seront-elles en 2026 ?
Du 21 au 24 août 2025, Poitiers accueillait les 7èmes « Rencontres nationales des listes citoyennes et participatives ». Des hommes et des femmes sont venus de nombreuses villes françaises pour se former et échanger sur une forme de démocratie plus directe en vue des prochaines municipales. En 2020, 384 listes citoyennes s’étaient présentées en France, combien seront-elles en 2026 ?
Une liste citoyenne et participative , c’est quoi ?
« Elles sont reconnaissables par une appétence procédurale et par une profusion d’expérimentations méthodologiques. Des modes de faire autrement sont manifestes à trois niveaux : fabrique citoyenne du programme, modes de sélection des candidat·es sophistiqués, engagement en faveur d’une action publique plus collaborative incluant des formes de démocratie directe en cas d’élection.
Ici le programme est construit avec les habitant·es, et mobilise des modes de faire campagne − ludiques, artistiques, numériques− dans l’espace public. Les candidatures sont issues du tirage au sort, de la co-désignation, d’élections sans têtes de listes et de listes sans candidat·es. Les décisions sont prises au consentement, au jugement majoritaire, à main levée, en ligne. Il en ressort de nouveaux profils de candidat·es et d’élu·es avec une forte tendance au rajeunissement, notamment féminin.
L’engagement en faveur d’une action publique plus collaborative, horizontale et éthique, et le recours à des outils de démocratie directe est un élément phare qui guide ce troisième type de LCP. Référendum d’initiative citoyenne, reconnaissance du droit d’interpellation, contrôle citoyen de l’action publique, révocabilité des élu·es, non-cumul des mandats, transparence, ces engagements sont inscrits dans des chartes éthiques et déontologiques co-signées par les candidat·es. ».
Municipales 2026. Les listes citoyennes s’organisent pour « rendre aux habitants le pouvoir de décider et d’agir »
Poitiers accueillait les 7èmes rencontres nationales des listes citoyennes et participatives. Des hommes et des femmes sont venus de nombreuses villes françaises pour se former et échanger sur une forme de démocratie plus directe avec les élections de 2026 en ligne de mire.
En pleine saison des universités d’été des partis politiques traditionnels, les listes citoyennes et participatives ont choisi Poitiers pour se retrouver du 21 au 24 août, à l’initiative de Poitiers Collectif (qui a porté Léonore Moncond’huy à la mairie de Poitiers en 2020) et du réseau Actions Communes, pour les 7èmes Rencontres nationales des listes citoyennes et participatives. Les plus de 200 groupes existants en France, dont des représentants ont fait le déplacement dans la Vienne, revendiquent une démarche citoyenne qui vise à « prendre le pouvoir pour le partager ».
Le citoyen au cœur du processus
Durant quatre jours, les échanges se sont nourris de l’expérience d’une soixantaine de communes déjà engagées dans ce mouvement appelé municipalisme citoyen. Il a été question de « gouvernance partagée », d’« implication directe des habitant.es », de « réappropriation des ressources locales (eau, énergie, alimentation) », mais aussi de « féminisation et de dépatriarcalisation de la vie politique ».
De Boulogne-sur-Mer à Montpellier, partout en France, le mouvement revendique la création de listes citoyennes et participatives qui se constituent en vue des prochaines élections municipales de mars 2026. Coorganisatrice de ces Rencontres, Laëtitia Hamot, maire divers gauche de La Crèche (79), ancre le mouvement dans une perspective commune qui vise à « redonner leur rôle aux habitants ». Élue en 2020 sur une liste citoyenne et participative, elle estime que l’enjeu est de pousser à la réinvention du rôle de maire : « peut-être de désacraliser un petit peu [s]a figure, et trouver le meilleur rôle pour l’ensemble des élus et puis aussi des habitants ».
Issue du mouvement Dijon Avenir, Mathilde Mouchet estime que la source de son engagement a été « la surdité de la municipalité face à des demandes d’associations et d’habitants sur les questions d’environnement et de cadre de vie ». Pour cette ingénieure en environnement et cofondatrice de Dijon Avenir, « être sur une liste citoyenne et participative, c’est vraiment revenir à la source et rendre aux habitants le pouvoir de décider et d’agir.”
L’enjeu est de montrer que c’est une force qui se monte, que ce ne sont pas juste quelques personnes, mais un mouvement national qui dispose d’expériences sur lesquelles se baser. Mathilde Mouchet Dijon Avenir
Venu d’Angers, Saïd Boukobaa a lancé une liste citoyenne dans sa ville : Angers Coopérative. Dans la vie, il est entrepreneur dans le domaine de la formation et du recrutement. Lui aussi souhaite remettre le citoyen au cœur de processus. « L’objectif c’est de refaire de la politique au sens noble du terme », explique-t-il. Il dit s’engager en faveur des habitants des quartiers populaires, pour « prendre en compte [leur] voix ». Il estime que « les quartiers populaires ont toujours été les oubliés des élections, notamment municipales ». « On vient les voir uniquement tous les six ans, on les considère comme un réservoir de voix et pas comme des gens à prendre en compte dans le projet municipal. »
Le mouvement semble vouloir apporter les réponses aux interrogations de celles et ceux qui disent « ne plus croire » dans le « système politique actuel ». Au cœur de leur questionnement : « Comment fait-on pour avoir une démocratie, notamment locale, plus ambitieuse ? » Ils voient dans les listes citoyennes et participatives le moyen de dépasser les logiques partisanes. « Les partis, selon moi, sclérosent un peu la politique parfois, même s’ils ont leur utilité et leur efficacité, estime Juliette Blayac qui travaillait dans le milieu associatif et politique avant de reprendre des études dans le domaine de la démocratie participative. Beaucoup de gens voient que ça n’avance pas vraiment. Le fait d’avoir des listes citoyennes et participatives permet selon moi (…) de se mettre dedans et d’être un acteur ». Agir en dehors du cadre d’un parti politique permettrait même aux citoyens de « prendre en main les choses et [de] prendre des décisions pour eux-mêmes ».
Mais avant cela, les participants reconnaissent volontiers qu’il leur faut lutter contre certains freins, notamment celui de la légitimité à s’engager : “Évidemment, on pense aux femmes, explique Laëtitia Hamot, ne serait-ce que pour passer le cap de devenir élue ». S’impliquer en politique peut aussi se révéler « compliqué pour les personnes en minorité, les personnes racisées, les personnes des classes populaires qui ne se sentent pas assez légitimes.” Pour la maire de La Crèche, ce « frein » doit sauter. Et ce ne serait pas le seul.
“Nous pouvons être taxés d’inexpérience au regard du fait que nous soyons de simples habitants, explique Mathilde Mouchet. C’est vraiment un enjeu de montrer que c’est une force qui se monte, que ce n’est pas juste quelques personnes à Dijon, mais vraiment un mouvement national et qu’il y a déjà des expériences sur lesquelles nous baser.”
« Nous sommes un collectif professionnel et militant composé de citoyen·ne·s, d’activistes, de chercheur·euse·s et d’élu·e·s. Nous agissons depuis plusieurs années pour transformer la démocratie. En 2020, nous avons créé Fréquence Commune pour mettre en action cette transformation par le bas en accompagnant des expériences concrètes et transformatrices dans les communes. » En savoir plus en consultant le site internet de Fréquence commune …
A suivre …


/regions/2025/08/25/rencontres-listes-participatives-poitiers2-68ac841eba9a5703808676.jpg)
